Les Moëlanais
Histoire locale
De octobre 1865 à février 1866, le choléra fait 83 morts à Moëlan

Le choléra à Moëlan
Une lecture attentive du nombre de décès en 1865 et 1866 fait apparaître un surnombre longtemps resté sans explication.
| Années | Nombre | Années | Nombre |
|---|---|---|---|
1860 |
133 |
1865 |
194 |
1861 |
89 |
1866 |
176 |
1862 |
106 |
1867 |
154 |
1863 |
119 |
1868 |
136 |
1864 |
97 |
1869 |
157 |
C'est en navigant sur la toile à la recherche de livres parlant de Moëlan que j'ai pu trouvé celui écrit par M. Henri Monod :
"Le Choléra – Histoire d’une épidémie – Finistère 1885-1886"
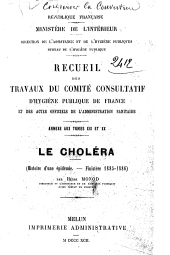
Page 25, en 1865, M. Monod situe le début de l'épidémie dans le sud du département et cite le nombre de décès dans les communes concernées :
| Communes | Nombre | Communes | Nombre |
|---|---|---|---|
| Trévoux | 2 |
Quimperlé et Riec | 23 |
| Névez et Trégunc | 3 |
Riec | 23 |
| Bannalec | 4 |
Concarneau | 78 |
| Nizon et Melgven | 6 |
Beuzec-Conq | 14 |
| Pont-Aven | 10 |
Moëlan | 83 |
"C'est à Moëlan, qu'à la date du 27 octobre 1865 l'on signale le premier décès. L'épidémie s'y propage pendant 4 mois, le nombre des morts est de 83. De Moëlan, l'épidémie s'étend dans les communes environnantes." Fin de l'épidémie le 20 février 1866.
Le choléra :
Le choléra est une infection intestinale aiguë due à l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés par le bacille Vibrio cholerae. La durée d'incubation est courte, de moins d'un jour à cinq jours. Le bacille produit une entérotoxine qui provoque une diarrhée abondante, indolore pouvant aboutir rapidement à une déshydratation sévère et à la mort du sujet si le traitement n'est pas administré rapidement. La plupart des patients présentent aussi des vomissements.
La plupart des sujets infectés par V. cholerae ne présentent aucun symptôme bien que le bacille puisse être présent dans leurs selles pendant 7 à 14 jours. En cas de maladie, 80 à 90 % des épisodes sont bénins ou modérément sévères et il est alors difficile de les distinguer cliniquement d'autres types de diarrhées aiguës. Moins de 20 % des malades développent le choléra typique avec des signes de déshydratation modérée à sévère (source OMS)
Intrigué par cet évènement, je décidais de poursuivre mon enquête afin de déterminer comment cette épidémie de Choléra avait-elle pu naître dans une petite commune du Finistère, dont l'emplacement et l'économie n'en faisaient pas un carrefour de communication.
La bibliographie de ce livre faisait référence à celui-ci: "La civilisation et le choléra" par Jules Girette édité en 1867.
Puissance infectieuse des objets contaminés :
Page 107: "Un autre fait avait attiré mon attention, en parcourant la liste des communes envahies en 1865. Dans le Finistère, tandis que Brest et Quimper étaient encore épargnées, une petite ville, Moëlan, frappée à mi-distance entre Quimperlé à peine touchée et Lorient entièrement indemne, subissait des pertes considérables, eu égard au chiffre de sa population. Voici les informations que j'ai recueillies, grâce à l'obligeant concours de M. le commissaire de la marine LE FRAPER (1). L'épidémie aurait été importée par un matelot de l'état venu, en congé de convalence, de Toulon où il avait été traité à l'hôpital maritime pour un cas de choléra. La mère et la soeur de ce matelot auraient contracté, en lavant son linge, le germe de l'épidémie dont elles ont été les premières victimes, et qui s'est propagée autour d'elles.
Dans ces deux cas, il s'agit de convalescents ayant voyagé à la suite de leur rétablissement, et transportant avec eux des effets à leur usage qui communiquent à qui les remue le germe de l'épidémie. Les faits de cette nature paraissent nombreux, et je n'ai insisté sur les exemples de Puisgros et de Moëlan que parce que j'ai pu en vérifier l'exactitude."