Patrimoine
Les moulins
- Généralités
- La vie des meuniers
- Le glossaire du meunier
- Le moulin l'Abbé
- Le moulin de Chef du bois
- Le moulin de Damany
- Le moulin Jaouen
- Le moulin de Kerascoët
- Le moulin de Kercaradec
- Les moulins de Kerduel
- Le moulin de Kerfany
- Le moulin de Kerglien
- Le moulin de Kergoustance
- Le moulin de Kerimel
- Le moulin de Kerloshouarn
- Le moulin de Kermeurbras
- Le moulin de Kermoulin
- Le moulin de Kernon largoat
- Le moulin de Kernon larmor
- Le moulin de Kerseller
- Le moulin de Kervardel
- Le moulin de Kervéligen
- Le moulin de Kervignac
- Le moulin de Keryoualen
- Le moulin de Petites Salles
- Le moulin de Poulvez
- Le moulin de Quililen
- Le moulin du Roziou
- Le moulin de la Villeneuve
- Le moulin du Duc
- Le moulin du Hirguer
- Les moulins Marion
- Le moulin mer
Les moulins

Note liminaire
Pour établir le plus précisément possible l’emplacement des anciens moulins de Moëlan, nous nous sommes appuyés sur les listes dressées par Gabrielle Meuric-Philippon (Moëlan en Cornouaille, p. 122) et par Maurice Chassain (Moulins de Bretagne, p.144).
Nous avons trouvé quelques noms de moulins dans le Papier terrier de la barre royale de Quimperlé, 1678 à 1682.
Le plan cadastral de Moëlan (1832) et les états de sections (1833) nous ont permis de localiser la plupart des moulins.
Quelques moulins plus récents ont été identifiés, grâce aux matrices cadastrales des propriétés bâties (1882-1911 et 1911-1969), que Philippe Dréno a dépouillées pour nous.
L’admirable travail de Marie-Claude Colliou (Terres et gens du Bélon, 2003) avait déjà détaillé les moulins à eau du Bélon. Son concours ponctuel à notre travail nous fut précieux.
Des plans des moulins du Duc et du Guilly, fruit d’une recherche de Jacques Noël aux Archives départementales du Finistère, nous ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de ces moulins du Bélon.
Nous avons aussi retenu les détails donnés par Gabrielle Meuric-Philippon (op. cit.) et Alain Bellec (Moëlan-sur-mer au fil des rues et des sentiers, 2013) sur quelques moulins et apprécié les témoignages de quelques Moëlanais.
Enfin, sans le colossal travail de généalogie mené depuis des années par Didier Loizon, ainsi que le remarquable site web de Mémoires et photos de Moëlan, nous n’aurions pu identifier celles et ceux qui faisaient tourner ces roues et ces ailes, tous ces meuniers et leurs familles.
Les articles à venir sont le résultat d’un travail à quatre mains que nous avons mené ensemble.
Que toutes ces personnes soient ici remerciées.
Malgré tout cela, il ne nous a pas été possible de localiser certains anciens moulins (à vent) dont le nom figure dans les listes ci-dessus nommées. En revanche, nous avons pu identifier quelques moulins qui n’y figuraient pas.
Laurence Penven, Avril 2020
![]()
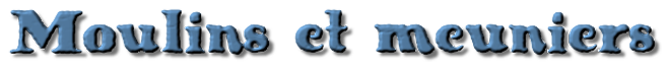
Moulins
« A eau » ou « à vent », très nombreux furent les moulins à Moëlan. Avant la Révolution, chaque seigneurie possédait un, voire deux moulins, où les domaniers étaient tenus de moudre leur blé. Dans les actes de déclarations et dénombrements (du Terrier de Quimperlé), lorsqu’un seigneur possède un moulin, il le déclare avec son « distroit », c’est-à-dire le territoire du moulin dans lequel le seigneur peut exercer le droit de banalité.
Le moulin faisait partie du domaine congéable, il était loué à un meunier. A l’occasion d’un bail, en général de 9 ans à Moëlan, était établi le « renable » ou inventaire du moulin. Ces renables sont des pièces extrêmement intéressantes car elles décrivent les biens mobiliers et immobiliers du meunier, en distinguant les biens propres du meunier des biens faisant partie du moulin. Il mentionne également les travaux effectués ou à prévoir pour l'entretien du moulin : machinerie, bief...
Il faut attendre la Révolution pour qu’apparaissent des meuniers propriétaires de leur moulin.
Les plus nombreux étaient les moulins à vent. Beaucoup avaient été construits aux XVIè et XVIIè siècles. Ils étaient souvent situés sur des hauteurs dégagées, essentiellement en bordure de côte. Ainsi, sur les terrains entre Brigneau et Kerfany, on a pu dénombrer une dizaine de moulins à vent. Les landes incultes offraient des terrains propices à ces constructions sans nuire aux cultures. Mais ils étaient parfois aussi construits sur des terres labourables.
Les moulins à eau quant à eux profitaient d’une retenue d’eau, d’un étang, ou d’une rivière, comme les moulins situés sur le Bélon, mais très souvent aussi d’un moindre cours d’eau, comme celui de Poulvez sur le ruisseau de Brigneau. Ces derniers étaient tributaires des saisons et ne pouvaient souvent pas fonctionner en période estivale. Alors, la présence d’un second moulin, à vent celui-là, et qui pouvait venir en relais, était fort appréciable.
Il n’y a pas eu de moulin à marée à Moëlan. Malgré son nom de « Moulin mer », ce dernier n’était pas un véritable moulin à marée (comme par exemple celui du Hénant en Névez), car il utilisait l’eau de la rivière, même si parfois il pouvait aussi profiter des très grandes marées.
On peut trouver des détails et une riche documentation sur les moulins à eaux ici.
Sur le territoire moëlanais, Gabrielle Meuric-Philippon dénombre une trentaine de moulin à vent tandis que Maurice Chassain en identifie vingt-et-un. Il y a eu une dizaine de moulins à eau.
 |
24 Kerhuel |
60 St Thamec |
|||
76 Kervétot |
|||||
70 Kerglouanou |
77 Tremorgat |
||||
64 Kertoutl-Porz |
71 Kergolaer |
||||
72 Blorimond |
|
||||
73 Kermen |
A vent |
||||
A eau |
Le moulin était un élément important du paysage rural. Beaucoup de noms de parcelles y font allusion. (« roz milin abat », le coteau du moulin l’Abbé, « prat milin an Damany », le pré du moulin de Damany, « parc ar vilin avel », le champ du moulin à vent …)
Du fait de leur position aisée à repérer, les moulins à vent étaient souvent choisis, ainsi que d’autres édifices remarquables, pour les opérations de triangulation utilisées par le géomètre pour lever le plan cadastral de la commune. Ces repères étaient représentés par un petit drapeau bleu, appelé « signal ».
Ludovic-Rodo Pissaro, « Le Moulin de Kergroës », début XXè siècle.
Les moulins à eau et les moulins à vent n’ont pas eu le même sort. S’il est relativement aisé de retracer l’histoire des moulins à eau, il n’en est pas de même de celle des moulins à vent, qui n’ont pas aussi bien traversé les siècles, à part quelques exceptions.
Entre 1678 et 1682, le « Terrier » de Quimperlé qui regroupe les déclarations et dénombrements des biens des seigneurs, mentionne encore plusieurs moulins.
Mais certains de ces moulins sont déjà déclarés en ruine, comme par exemple, le moulin à vent de Kercaradec. (Dépendant de Kermoguer)
A la Révolution, plusieurs de ces moulins, à eau essentiellement, sont achetés en tant que biens nationaux, souvent par les notables de la nouvelle classe possédante. Ainsi, le moulin de Chef du bois, ou moulin l’Abbé, par Louis Archin, marchand de biens à Lorient et le moulin du Duc par Vincent Honoré Marie Billette, receveur des finances à Quimperlé.
En 1832, 11 moulins sont imposables. 9 anciens moulins à eau sont encore en fonctionnement, mais la plupart des anciens moulins à vent, ceux qui dataient du XVIè et XVIIè siècles sont en ruines ou démolis. Les causes en sont multiples : coup de vent décoiffant les tours, guerres, ou plus simplement négligence et mauvaise gestion (1). Il ne reste que deux moulins à vent en activité : le moulin de Kerjégu et le moulin d’Hirguer.
Sur les états des sections du cadastre napoléonien seuls les noms de certaines parcelles sont alors les témoins de l’ancienne présence de ces moulins à vent.
Mais le début du XIXè siècle fut aussi un moment propice à l’édification de nouveaux moulins. Les paysans, désormais propriétaires de leurs terres, peuvent faire construire. Selon un rapport du Conseil général du Finistère, après le passage révolutionnaire, les petits moulins se multiplièrent. La construction d’un moulin à vent est bien plus aisée que celle d’un moulin à eau : peu de formalités administratives, pas de conflit à craindre avec le meunier d’amont ou celui d’aval, …frais de construction moins élevés aussi puisqu’il se suffisait à lui-même et ne connaissait aucune contre-partie des vannes, digues, chaussées, pêcheries…compliqué et coûteux équipement des moulins à eau. (2)
A Moëlan, entre 1848 et 1851, deux très anciens moulins (Kerjégu, Hirguer), sans doute devenus vétustes, vont subir des travaux de démolition, puis de reconstruction. D’autres moulins à vent vont être construits entre 1849 et 1879 : Kerroch (1848), Chef du bois (1849), Keranglien (1849), Kernon Largoat (1857), Marion (1879), qui fut sans doute le dernier construit.
Lorsqu’ils sont proches d’un moulin à eau, bâtis sur un coteau voisin, il arrive que ces moulins à vent deviennent de précieux auxiliaires des moulins à eau, surtout en période d’étiage, et soient alors exploités par une même famille de meuniers. Ce fut pendant quelques années le cas des moulins de Kernon Largoat et de Poulvez, de Kerglien et de Damany, de Chef du bois et de la Villeneuve.
Mais le déclin est là. Tous ces moulins construits au milieu du XIXe siècle seront peu à peu démolis à partir de 1890.
Le dernier moulin à vent en service à Moëlan, le moulin Jaouen, cessa de fonctionner vers 1940.
Les moulins à eau survécurent plus longtemps. Huit étaient encore en service en 1882 : Le moulin du Duc, de Damany, le moulin à mer (Guilly), le moulin Marion, le moulin neuf de Kerseller, le moulin l’Abbé, de la Villeneuve et le moulin neuf de Kervéligen. Et quelques-uns même encore au début du XXè siècle. Le dernier fut celui de Damany qui cessa toute activité en 1967.
D’une façon générale, les moulins artisanaux ont disparu avec l’apparition de la minoterie industrielle au XXe siècle et la généralisation de l’électricité.
Meuniers
Le meunier est le personnage-clé d’une société dont la base de subsistance est le pain. (3)
La grande majorité des familles paysannes vers 1840 vit dans la pluri-activité. On ne peut faire vivre une famille sur une exploitation de moins de dix hectares. Le meunier a souvent plusieurs activités : cultivateur, pêcheur, voire sonneur de bombarde…Souvent, le métier de meunier n’est même pas indiqué dans les recensements de population. « Cultivateur » est le terme qui est le plus souvent employé.
Et le meunier peut avoir aussi une mauvaise réputation ! « Voleur » et « joyeux luron » sont souvent les deux qualificatifs des meuniers dans les complaintes et autres dictons populaires.
Comme souvent ailleurs en France, Moëlan a connu des « dynasties » de meuniers, à savoir la transmission du métier des parents aux enfants sur au moins trois générations. Tant il est vrai que le travail de meunerie demande un long apprentissage, qui commence dès l’enfance. (4)
Dès 13 ou 14 ans, les enfants de meuniers étaient souvent servantes, valets ou garçons-meuniers et se connaissaient d’un moulin à l’autre.
Lorsque le moulin est construit par un meunier, et qu’une dynastie s’y installe, il porte alors le nom de ces meuniers plutôt que celui du village.
On peut ainsi citer les familles Jaouen au moulin de Kerjégu (devenu Moulin Jaouen après sa reconstruction), Hervé au moulin de Kerroc’h (devenu Moulin Kerhervé).
Autres dynasties de meuniers : la famille Le Pennec au moulin du duc et au moulin mer, et aussi la famille Favennec du moulin de Damany, descendant de Yves Guenou et Yvonne Chaperon (1638-1688).
Fréquentes étaient aussi les alliances entre familles de meuniers qui constituaient une classe très liée aux paysans aisés, prévoyant les mariages dans ce cercle qui veille à conserver les propriétés. (5)
Jacques Hervé, du moulin de Poulvez épouse Sulpice Le Dren, du moulin neuf de Kervéligen, vers 1719.
A la fin du XVIIIè siècle, par le jeu de ses alliances, la famille Guitton a des meuniers à la fois au moulin de Damany, au moulin l’Abbé et au moulin de Poulvez.
Les alliances se faisaient aussi entre meuniers de communes différentes. Le Bélon ne connaissait pour cela pas de frontière et c’est ainsi que la famille des meuniers Limbourg s’est installée tant sur la rive droite en Riec (Moulin Nézet) que sur la rive gauche en Moëlan (Moulin du duc). En 1876 Jean-Marie Limbourg (1842-1888) épouse Marie-Perrine Eon (1833-1888) du moulin du Duc.
Mais le débit des rivières et l’usage que les meuniers en font est souvent source de conflits entre meuniers d’amont et meuniers d’aval. Ainsi, la construction du moulin dit « neuf » de Kerzeller en 1819 sur la rive gauche du Bélon mécontente le meunier de Nézet, (Riec) en amont. L’usage des vannes doit être réglementé devant notaire.
Mésentente aussi en 1862 entre le meunier Madic de moulin mer et les sœurs Eon du moulin du Duc.
Le dernier meunier de Moëlan fut celui du dernier moulin à eau, celui de Damany : Melaine Favennec (1903-1985), le dernier d’une dynastie de 300 ans.
![]()
La littérature sur les moulins est abondante.
Pour Moëlan, retenons les ouvrages de :
BELLEC, Alain, Moëlan-sur-Mer, au fil des rues et des sentiers, Le Faouët : Liv'Editions, 2013.
CHASSAIN, Maurice, Moulins de Bretagne, Spézet : Keltia Graphic, 1993.
COLLIOU-GUERMEUR, Marie-Claude. Terres et gens du Bélon 1789-1920, des sources à la mer, 2003.
MEURIC-PHILIPPON, Gabrielle. Moëlan en Cornouaille, 1975.
(1) Durand-Vaugaron, Louis. Le Moulin à vent en Bretagne, Annales de Bretagne, tome LXXIV, N°2, juin 1967. p.14
(2) Ibidem
(3) Coulliou Marie-Claude, Terres et gens du Bélon, 1789-1920, Des sources à la mer.2003. p. 104
(4) Ibidem
(5) Ibidem, p. 105
